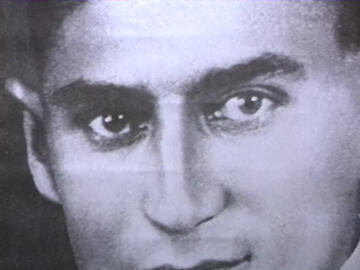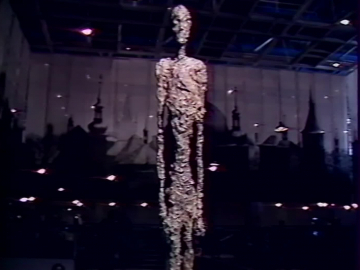L'ANNIVERSAIRE.
L’œuvre de l'écrivain austro-hongrois, né le 3 juillet 1883, ne cesse d'inspirer et de fasciner. Franz Kafka, qui croyait si peu en son talent d'écriture, est pourtant l'un des écrivains qui a le plus passionné et inspiré. Les textes de Kafka, devrait-on dire, ses univers opaques, poursuivent leur cheminement dans les esprits épris de littérature, mais pas seulement. Ses personnages aux prises avec des situations cauchemardesques, absurdes, souvent fantastiques, offrent des récits intemporels d'expériences universelles, ressenties et donc comprises par delà les cultures, les frontières et les époques.
L’ÉCRIVAIN.
Franz Kafka est né le 3 juillet 1883 dans le royaume austro-hongrois au sein d'une famille juive de Prague. Il a deux frères, tous deux morts avant lui et trois sœurs, qui seront déportées pendant la Seconde Guerre mondiale et périront dans les camps nazis. Le jeune homme qui entretient des relations difficiles avec son père, entreprend des études de droit en Allemagne et débute par la suite une carrière dans les assurances. Cependant, il ressent également un attrait pour la littérature et commence à écrire en parallèle de son travail qu'il qualifiait d'alimentaire. L'auteur s'exprime en allemand, la langue majoritaire dans le Prague de l'époque. En 1917, Kafka est atteint de tuberculose. Par la suite, sa santé précaire ne va cesser de se dégrader et l'homme va passer de sanatoriums en maisons de repos. Il s'éteint finalement à l'âge de 40 ans, le 3 juin 1924. Son corps est enterré à Prague le 11 juin 1924.
Nous vous proposons de commencer cette exploration de l'univers littéraire de Franz Kafka par une archive de 1983 disponible en tête d'article. Elle dresse le portrait de l'écrivain. À l'époque, à l'occasion du centenaire de sa naissance, le musée d'art juif de Paris, situé à Montmartre, avait organisé une exposition intitulé « A la recherche de Franz Kafka ».
Il était dépeint comme l'un des auteurs les plus énigmatiques de notre temps. « Kafka, grand nerveux, doutant de lui-même, insomniaque, victime de toutes sortes de hantises, tuberculeux… écrivant dans un allemand provincial et se sentant doublement minoritaire. Étranger, à part, en conflit avec une famille qui ne le comprenait pas, avec un père particulièrement formaliste. Kafka poursuivit par la peur de l’impuissance et qui ne s’est jamais résolu au mariage ». C'est cet écrivain, sujet au doute, méconnu de son vivant, qui allait devenir l'un des fondateurs de la littérature moderne.
Le monde kafkaïen
Kafka vécut l'écriture comme un besoin viscéral et essentiel, une nécessité douloureuse et un don entier de sa personne, allant jusqu'à la perte de son identité : « une ouverture totale du corps et de l'âme », disait-il. Son œuvre se caractérise par une atmosphère étrange, lourde, parfois absurde, voire cauchemardesque, où la bureaucratie et la société impersonnelle étouffent l'individu jusqu’à l'annihiler. Cette ambiance a d'ailleurs donné naissance à l'adjectif « kafkaïen », qui décrit une situation sinistre ou dérisoire, sans issue. En effet, pour Kafka, l'écriture est assez similaire un tunnel sombre, dans lequel ses personnages s'engagent sans savoir quel sera leur sort ultérieur.
Mais c'est aussi l’œuvre d'un rebelle qui délivra un message de résistance contre toutes les tyrannies : familiales, conjugales, sociales. Il fréquenta d'ailleurs les cercles anarchistes de Prague aux alentours des années 1910-1912, une influence qui colora deux de ses œuvres, La Colonie pénitentiaire ou Le Procès. Bien que son œuvre soit vaste, seuls ses courts récits, et quelques nouvelles, ont été des succès publics. Parmi ses romans les plus connus, toujours largement étudiés dans les programmes scolaires, demeurent Le verdict, Le Procès, L'Amérique et Le Château (texte inachevé), ainsi que des nouvelles dont La Métamorphose et La Colonie pénitentiaire.
L'archive suivante est assez emblématique des sentiments suscités par la lecture de Kafka. Il s'agit d'un extrait du magazine littéraire de « Lectures pour tous ». Nous sommes en mai 1965 et Pierre Dumayet reçoit l'écrivain et le prix Nobel de littérature (1952) François Mauriac (1885-1970). Lorsque la conversation s'arrête sur Franz Kafka, l'académicien, qui se déclare être un grand admirateur de Kafka, fait une révélation surprenante et particulièrement cocasse.
François Mauriac ne relit pas Kafka
1959 - 00:29 - vidéo
« J’aime profondément Kafka, l’homme Kafka, mais ses livres ! Mais ses livres, je les ai lus une fois, mais plutôt crever que d’y rentrer (à nouveau). Je n’ai jamais envie de recommencer un cauchemar. Moi, j’ai une peur terrible des cauchemars, mais ça ne m’empêche pas d’aimer terriblement Kafka. Son journal. Oui ! Ses lettres. Oui ! Tout ce qui est lui. Oui ! Mais ses romans que j’admire, je les ai lus une fois, mais je n’y reviendrais jamais » !
Univers kafkaïen
Cette réaction, quasiment épidermique, reflète bien la nausée que peut provoquer la lecture d'un roman de Kafka. Avant d'y revenir, nous allons nous intéresser à la correspondance évoquée par François Mauriac ci-dessus. L'occasion de faire connaissance avec l'homme qui permit aux lecteurs français de découvrir Kafka en 1925. Il s'agit d'Alexandre Vialatte (1901-1971). Un écrivain, critique littéraire et traducteur français qui vivait à Berlin au milieu des années 20 et auquel on avait demandé de traduire Franz Kafka en français.
Celui qui deviendra plus tard rédacteur des « Nouvelles littéraires » et de « La Nouvelle Revue française » s'éprit de l'univers kafkaïen, lors de la parution du roman Le Château. En 1956, il évoquait longuement une autre partie de l’œuvre de Kafka, ses correspondances. Il venait de traduire Lettres à Milena. De longs échanges épistolaires avec celle qui fut capable d'émouvoir Kafka, lui qui eut des relations, souvent compliquées, avec les femmes.
Dans l'archive ci-dessous, de 1956, Alexandre Vialatte était l'invité du magazine « Lectures pour tous ». Cette correspondance, traduite par Vialatte, datait de 1921-1922, deux ans avant la mort de l'écrivain. Le traducteur racontait les circonstances de la rencontre entre Kafka et Milena Jesenska, une femme mariée, fougueuse et solaire. Leur relation resta platonique et épistolaire, les deux « amants de plume » ne se rencontrant qu'à deux ou trois reprises.
Tout en lisant quelques beaux passages des lettres échangées, Alexandre Vialatte expliquait que dans ses missives, Kafka se rabaissait, se comparant « à un animal dans la forêt qui ne supportait pas le soleil ». L'astre symbolisait cette femme radieuse et idéalisée. Leur relation, l'auteur la décrivait comme un « amour de tête infiniment vécu ». On retrouvait dans cette correspondance des thèmes chers à l'auteur tels celui de l’impasse, qu’il décrivait comme « une taupe dans un terrier sans issue » face à un mur. Il y avait aussi la solitude, sa relation compliquée à son père... En 1919, il écrivit Lettre au père dans lequel il revenait sur leur relation conflictuelle teintée d'incompréhension. Lettre qu'il n'envoya jamais, mais qui fut publiée à titre posthume, en 1952. Une missive considérée comme une clé de compréhension de l'œuvre de l'écrivain. Sa réflexion, sa sensibilité, son don d'observation d'autrui lui permirent d’aborder des thématiques peu usitées. A l’image de la liberté, un thème récurrent de l’auteur qui n’était pas à rechercher, selon lui, à l’extérieur, dans le mouvement, mais en soi, cet espace intérieur, infini, appartenant à chaque être.
Alexandre Vialatte à propos des "Lettres à Milena" de Franz Kafka
1956 - 09:04 - vidéo
« Toute situation chez Kafka est le nœud gordien (…) C’est sa personnalité qui impose son œuvre à sa vie… On ne peut pas faire de distinction entre l’intérieur et l’extérieur ».
« Tout ce qui n'est pas littérature m'ennuie »
Ce sont les traductions d'Alexandre Vialatte qui, avec celles de Claude David, firent autorité dans l'édition des œuvres de Kafka dans la Pléiade à partir de 1976. Mais, bien avant la parution de la Pléiade, il fallut attendre 1964 pour que le lectorat français ait accès à l'ensemble des parutions de l'écrivain. L’œuvre complète de Kafka fut éditée pour la première fois en France à l'occasion du quarantième anniversaire de sa mort. On la doit à Claude Tchou, le créateur du « Cercle du Livre Précieux », dans une édition établie et annotée par l'éditrice Marthe Robert. En juin 1964, à la parution des huit tomes de la collection, Marthe Robert était reçue dans l'émission « La vitrine du libraire » pour présenter les ouvrages illustrés par Louis Mittelberg, alias Tim, l'illustrateur.
Les textes étaient présentés de manière chronologique et Marthe Robert revenait sur sa démarche. Dans son édition, l'éditrice avait considéré comme incontournable de respecter les ratures et les notes de Franz Kafka dans ses manuscrits et de les reproduire tels quels. La tendance littéraire considérait que Franz Kafka était un auteur sans évolution, ce qu'elle démentait en analysant sa manière d'écrire. Elle racontait que Franz Kafka pouvait écrire onze récits simultanément, avec la même technique de juxtaposition des épisodes, qui étaient, à chaque fois, presque achevés et donnaient tout leur sens au récit. Elle ajoutait que l'extrême subjectivité de ce qu'il racontait, était masquée par une apparente impartialité, un détachement, comme s'il s'agissait toujours d'une troisième personne dont il était question. Ce détachement, si caractéristique des personnages de son œuvre, l'auteur l'avait exprimé ainsi : « Tout ce qui n'est pas littérature m'ennuie et je hais même les conversations sur la littérature. »
Marthe Robert présente l'édition de Kafka
1964 - 11:00 - vidéo
La légende du feu
Dans l'archive précédente, le présentateur évoquait brièvement la légende selon laquelle Kafka aurait demandé à son meilleur ami de détruire toutes ses œuvres, après sa mort, parce qu'il avait une mauvaise opinion de son travail et de ses qualités d'auteur. Cet ami, c'était le poète allemand Max Brod, rencontré en 1901. C'est lui qui publiera la plus grande partie des œuvres de Kafka après sa mort. L'écrivain lui aurait bien demandé, en tout cas par courrier, de détruire une partie de son travail.
Dans un ouvrage de 1972, il avait d'ailleurs fait paraître une lettre reçue, en ce sens : « Voici, mon bien cher Max, ma dernière prière : Tout ce qui peut se trouver dans ce que je laisse après moi (c'est-à-dire, dans ma bibliothèque, dans mon armoire, dans mon secrétaire, à la maison et au bureau ou en quelque endroit que ce soit), tout ce que je laisse en fait de carnets, de manuscrits, de lettres, personnelles ou non, etc. doit être brûlé sans restriction et sans être lu, et aussi tous les écrits ou notes que tu possèdes de moi ; d'autres en ont, tu les leur réclameras. S'il y a des lettres qu'on ne veuille pas te rendre, il faudra qu'on s'engage du moins à les brûler. À toi de tout cœur. »
Max Brod n'a jamais clairement démenti cette rumeur, sans vraiment la confirmer. C'est ce que montre l'archive ci-dessous. Il s'agit d'un extrait de l'émission « Le cercle de minuit » de 1997, consacrée à Kafka, dans laquelle Laure Adler avait diffusé une archive allemande de 1965 dans laquelle Max Brod revenait sur cette légende. À la suite de ce document, Claude David, celui qui fit éditer Kafka dans la Pléiade, revenait sur cette histoire.
Max Brod et Claude David à propos de Kafka
1997 - 03:24 - vidéo
Cent ans après sa mort, Kafka reste l'un des plus importants auteurs du XXe siècle. Un écrivain transgénérationnel, dont la lecture se poursuit, de génération en génération. Lui qui ne trouvait rien d'exceptionnel dans ses récits empreints de critique sociale et teintés de surréalisme, ne se démode pas. Bien au contraire. Dans cette période où pointent l'intolérance, l'autoritarisme et la déshumanisation, la modernité de ses textes ont beaucoup à nous dire sur les forces inconnues qui manipulent le destin des hommes à leur insu. Ils ne cessent d'interroger sur la condition humaine et sur notre rapport ambivalent à l’autorité et à la liberté.
Avant la diffusion du téléfilm « La métamorphose », réalisée par Jean-Daniel Verhaeghe et Roger Vrigny, Jérôme Garcin interrogeait Pierre Desproges, humoriste et Jean-François Josselin, auteur et critique littéraire sur Kafka et cette œuvre en particulier.
Sur le même sujet